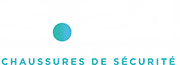Dans de nombreux secteurs d’activité, le port des chaussures de sécurité se veut obligatoire par rapport à la pluralité des risques que présentent les environnements de travail : risques de choc, d’écrasement, de perforation, de glissement, etc. En 2018, 24% des lésions occasionnées par des accidents du travail étaient localisées dans les membres inférieurs. Parfois, si les pieds ne sont pas directement touchés, c’est une déficience à leur niveau qui engendre des blessures sur le reste de la chaine musculaire et articulaire. Un glissement engendre un faux mouvement et le dos se bloque. Une douleur sous le pied et la personne compense en adoptant une posture contraignante qui impacte les articulations sus-jacentes comme les genoux, les hanches ou le dos. La chaussure de sécurité a donc une place importante dans la prévention face au risques du travail.
Observons les différentes obligations qui gravitent autours de la chaussure de sécurité.
Les obligations de l’entreprise et du salarié
Chaque entreprise doit produire un Document Unique qui rassemble les risques encourus par les salariés suivant le poste occupé. L’entreprise doit mettre en face de chaque risques les solutions apportées par l’entreprise pour garantir la protection des travailleurs comme le stipule l’Article R4321-1 du code du travail.
Si l’employeur ou le responsable de la sécurité mentionne dans le document unique puis dans le règlement intérieur que les chaussures de sécurité sont nécessaires pour garantir la santé et l’intégrité des salariés, alors leur port est obligatoire pour ses derniers. L’idée est de créer un espace de travail sécurisé afin que le salarié puisse s’accomplir dans son travail en limitant un maximum les risques.
Concernant les chaussures de sécurité, l’employeur doit veiller à ce qu’elles soient maintenues dans un état de fonctionnement et d’hygiène satisfaisant à travers des entretiens, réparations voire le remplacement si nécessaire.

Refus du port de chaussures de sécurité : comment cela se passe ? Le salarié peut-il signer une décharge ?
Comme le stipule l’Article L4122-1 du code du travail, le salarié est dans l’obligation de respecter le règlement intérieur mis en place par l’entreprise et ainsi de respecter le port des EPI si le règlement le stipule. Le salarié peut refuser le port des chaussures de sécurité seulement sur prescription médicale. Par exemple pour les personnes présentant des pathologies tel que les halux valgus qui empêchent le port des chaussures de sécurité. Seul un médecin ou médecin du travail peut établir une contre indication au port de ces équipements. Et en aucun cas, l’employeur ne peut faire signer une décharge à son salarié.
Le refus de porter ces équipements pour la seule raison de ne pas les supporter n’est pas recevable (Cette petite phrase “je ne supporte pas les chaussures de sécurité” qui revient si souvent… !) Sans prescription médicale, il faut en parler avec son employeur pour trouver la chaussure qui vous convient ou bien essayer de mettre des semelles de confort adaptées aux chaussures de sécurité. Utiliser de bonnes chaussettes ou bien en changer durant la journée peut aussi aider. Enfin, prendre contact avec un podologue ou un orthopédiste peut permettre de trouver une solution adaptée, via des prothèses par exemple.
Dans un cas classique, le salarié qui refuse de porter ses chaussures de sécurité peut se voir adresser un avertissement et dans un cas extrême un licenciement pour faute grave. En effet, l’employeur est tenu de veiller au bon port des EPI et il engage sa responsabilité lorsque ses salariés travaillent sans EPI. Vous trouverez sur ce lien un exemple de jugement en ce sens.
Un article qui pourrait vous intéresser > Port des EPI : tous responsables.
Le cas du travailleur seul et indépendant
Dans le cas d’un artisan indépendant par exemple, vous êtes responsable de vous-même. Disons qu’il s’agit de bon sens : si votre entreprise tourne seulement grâce à vous, il serait dommage de mettre en péril sa pérennité en prenant le risque de travailler sans protection.
Qui doit payer les chaussures de sécurité ?
Comme le dit l’Article R4323-95 du code du travail, les EPI doivent être fourni gratuitement par l’employeur à partir du moment ou l’entreprise a jugé le port des chaussures de sécurité nécessaire.
Le salarié ne doit en aucun cas supporter la charge financière d’un EPI et donc des chaussures de sécurité.
Certaines entreprises pratiquent le système de donation : elles donnent une enveloppe au salarié afin qu’il choisisse lui-même ses chaussures de sécurité. Libre à lui d’ajouter du budget pour s’offrir la chaussures de sécurité de son choix.
Le cas des travailleurs temporaires
Dans le cas des travailleurs temporaires comme les intérim, c’est soit l’entreprise utilisatrice qui fournit les chaussures de sécurité, soit l’entreprise de travail temporaire (ex : agence d’intérim) elle-même.
Dans les deux cas, le salarié temporaire ne doit pas supporter la charge financière des EPI comme le stipule l’Article L1251-23 du code du travail

Un salarié peut-il remplacer les chaussures de sécurité fournies par l’entreprise par des chaussures de sécurité qu’il a lui-même acheté ?
Normalement non. C’est l’employeur qui doit fournir les chaussures de sécurité avec un cahier des charges précis pour des raisons d’assurance. Si l’employé juge que les chaussures de sécurité fournies par l’entreprise ne sont pas adaptées à son confort, alors il peut envisager d’en acheter lui-même. C’est une discussion qu’il faut avoir avec l’employeur. Si l’employeur refuse que la salarié achète lui-même ses chaussures de sécurité, alors il faudra que le salarié obtienne un avis médical attestant que les chaussures de sécurité de l’employeur ne lui conviennent pas pour des raisons médicales.

Si l’employeur accepte ou que le médecin préconise l’achat externe du salarié, il faut ce dernier respecte le cahier des charges qui a été mis en place par l’employeur notamment au niveau de la norme que doit respecter la chaussure de sécurité (ex : une chaussure de sécurité montante S3 SRC). La salarié doit fournir les documents attestant de la validité de la chaussure de sécurité tel que le certificat de conformité. De cette façon l’employeur sera couvert en cas d’accident.
A ce sujet, attention tout de même aux chaussures de sécurité soi-disant révolutionnaires qui circulent sur le web et qui ont dû mal a respecter les tests normatifs lorsque l’on y regarde de plus près.
Accident du travail sans chaussures de sécurité : qui risque quoi ?
Difficile de faire une généralité dans la réponse à cette question car elle dépendra bien sûr des circonstances de l’accident, de ses conséquences et de la responsabilité de chacun. Mais tout le monde a à y perdre si un accident du travail se produit dans une situation où les équipements de protection individuels n’étaient pas portés.
L’employeur a une obligation renforcée de sécurité des moyens. Il doit faire le nécessaire pour protéger les travailleurs et avoir pris les mesures suffisantes. S’il ne respecte pas cette obligation, il s’expose à une réparation financière de préjudice devant le pôle social du tribunal judiciaire pour une faute inexcusable. Les manquements à ces obligations peuvent aussi faire l’objet d’une condamnation pénale au tribunal correctionnel.
Si le salarié est à l’origine de la faute et qu’il est victime de l’accident du travail, il peut perdre tout ou partie de son indemnisation par la CPAM. En allant plus loin, si la faute a causé des blessures à autrui, voire un décès, il peut même être sanctionné pénalement.
Les secteurs d’activité dans lesquels le port des chaussures de sécurité est bien souvent obligatoire
La port des chaussures de sécurité est rendu obligatoire dans la plupart des entreprises des secteurs d’activité suivants :
- L’artisanat et le bâtiment (second œuvre et gros œuvre)
- Les travaux publics
- Les industries
- La maintenance
- Les métiers du transport, de la logistique et de la manutention
- Les métiers d’extérieur comme terrassier, aménagements d’espaces verts ou forestiers
- Les métiers de l’agro-alimentaire et de la cuisine
- Les métiers hospitaliers ou de services
- etc.